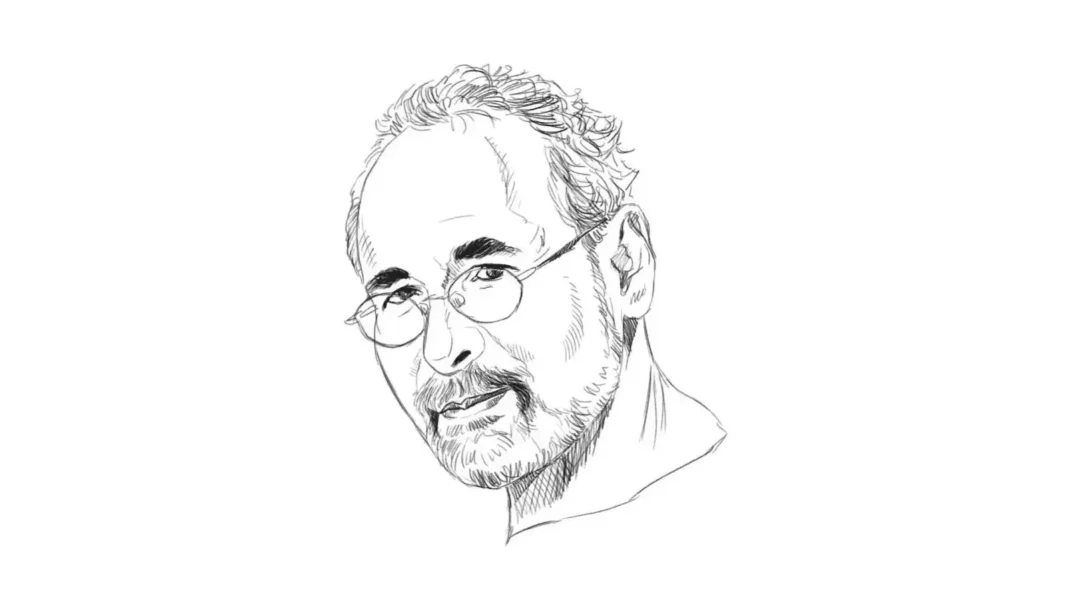Faute de parvenir à retirer un soutien confortable des urnes, la mouvance écolo-décroissante a investi un tout autre champ de bataille : celui de la justice. Mais il ne s’agit plus de transformer les salles d’audience en tribune médiatique, comme ce fut le cas lors des procès des Faucheurs Volontaires d’OGM, où, quel que soit le verdict, les prévenus étaient toujours politiquement gagnants. Gagnants lorsqu’ils obtenaient gain de cause, et gagnants encore lorsqu’ils étaient condamnés, car cela leur permettait de revêtir le costume de « victime du système ». Désormais, c’est grâce à des recours devant les tribunaux administratifs, des saisies du Conseil d’État et, indirectement, par les demandes auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), que la nébuleuse écologiste engrange des victoires. L’arrêt de la CJUE concernant la question des dérogations pour les produits phytosanitaires en est un bel exemple, tout comme l’arrêt qui stipule que les organismes obtenus par la technique de la mutagenèse constituent bien des OGM et sont donc, sauf exception, soumis aux obligations prévues par la directive sur les OGM.
Il en va de même à l’échelle nationale. « Aéroports, fermes-usines, barrages, entrepôts, centres commerciaux… Les grands projets inutiles et dévastateurs prolifèrent en France », note le site Reporterre, qui dresse une carte impressionnante de ces multiples points de conflits : « Notre carte compte 127 luttes réparties en sept catégories : bétonnage, transport, énergie, industries, agriculture, déchets et commerces. » Tout récemment encore, la flambant neuve centrale hydroélectrique de Sallanches (Haute-Savoie) n’a pas pu être mise en service en raison d’un recours déposé devant le tribunal administratif de Grenoble par une association écologiste, qui a obtenu gain de cause.
Comment expliquer ce déferlement d’arrêts de projets, pourtant profitables à la société, prononcés par des magistrats venus sans aucun doute d’horizons politiques différents ? L’explication est simple. À force d’introduire dans le droit français – et européen – des textes législatifs donnant la prééminence à l’environnement, le climat ou la biodiversité, au détriment du secteur productif et de la croissance économique, on se retrouve ainsi avec un paradigme juridique placé sous la tutelle de l’écologie politique. Et si la porte d’entrée en fut bien entendu l’inscription du principe de précaution dans la Constitution française et dans le droit européen, le long cortège de textes législatifs (loi sur la biodiversité, loi sur le climat, etc.) a fait le reste. Car, in fine, c’est bien sur cet appareil législatif empreint d’écologie que se fondent désormais les magistrats, tant en France qu’à l’échelle de l’Union européenne. On ne remettra donc réellement la croissance en route qu’au prix d’un sérieux toilettage législatif…