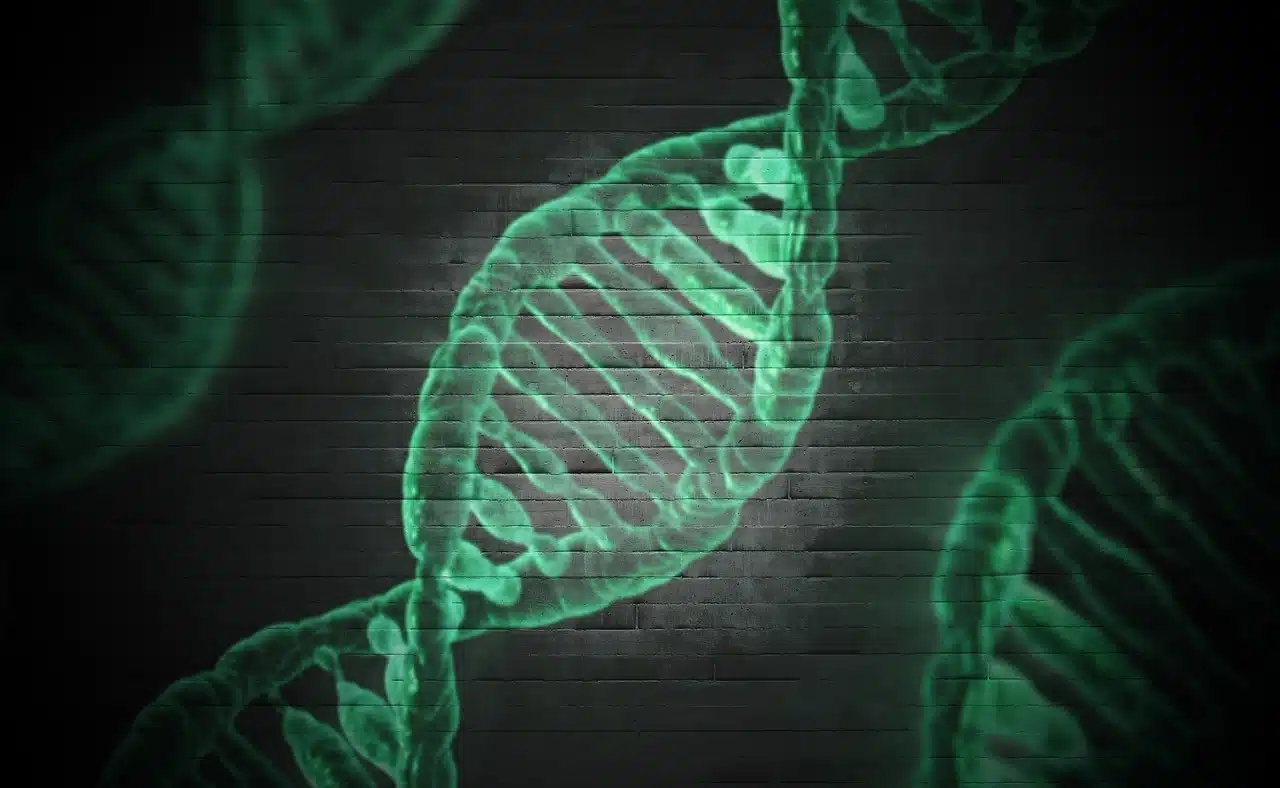Révolution en biologie chez les bêtes d’élevage : l’hérédité des caractères acquis remise en cause.
Entretien avec le Dr Jean-Louis Thillier, consultant scientifique européen (première partie).
Lire la deuxième partie du dossier :
Révolution en biologie chez les vaches laitières :
l’hérédité des caractères acquis remise en cause.
Un nombre croissant d’articles scientifiques met en évidence le fait que l’ADN ne serait pas le seul mécanisme permettant l’expression des gènes. Qu’en pensez-vous ?
Jean-Louis Thillier : L’expression génétique résulte de mécanismes très complexes, dont la science moderne a commencé à nous révéler les mystères. Les quelque 50 000 milliards de cellules qui constituent un mammifère sont issues d’une cellule unique – le zygote – qui se forme quand un spermatozoïde fusionne avec un œuf. À partir de la première division de ce zygote, une multitude de divisions cellulaires permet donc la création d’un corps complet. En se divisant, les cellules se différencient de plus en plus les unes des autres pour former des types de cellules spécialisées. Par la microscopie électronique ou par l’étude du protéome, c’est-à-dire de l’ensemble des protéines exprimées dans une cellule, on observe des différences très importantes entre, par exemple, une cellule de la peau et celle d’un neurone. Comment expliquer cette différenciation, quand chaque cellule de notre corps provient de la division d’une seule cellule de départ et qu’elle commence avec exactement le même matériel génétique que les autres ? Les cellules spécialisées inactivent-elles les
gènes qu’elles n’utilisent pas ? Devenus silencieux, ces gènes pourraient-ils ou non être réactivés ? À mesure que les cellules se font plus spécialisées, perdent-elles les gènes dont elles n’ont pas besoin ?
Pour répondre en partie à toutes ces questions, Ray K. Ng et John B. Gurdon 1 ont pris le noyau d’une cellule moyennement différenciée d’un crapaud adulte pour l’insérer dans un œuf non fécondé dont le noyau avait été retiré. Ils voulaient voir si une cellule tissulaire d’un crapaud adulte contenait toujours tout le matériel génétique avec lequel elle avait démarré. Et en effet, par cette technique, de nouveaux crapauds ont pu être créés.
La transplantation de noyaux de cellules somatiques sur des œufs énucléés a ainsi montré que les gènes peuvent être reprogrammés selon un schéma d’expression embryonnaire. En revanche, en utilisant le même système, mais en transférant un noyau d’un type de cellule très différencié, les chercheurs ont montré qu’il était impossible de créer des crapauds. Cela validait donc l’hypothèse selon laquelle un événement d’inactivation irréversible avait bien eu lieu au fur et à mesure de la différenciation des cellules. À supposer qu’il y ait quelque chose dans les cellules qui puisse garder certains gènes activés ou désactivés dans différents types de cellules, cela ne pouvait pas provenir de la perte d’une partie du matériel génétique. Autrement dit, les chercheurs ont conclu qu’il existait un système de contrôle de l’utilisation des gènes de l’ADN, et que les effets en sont hérités lorsque les cellules se divisent. C’est ce qu’on a baptisé « le système épigénétique ».
Et de quoi s’agit-il exactement ?
Alors que la génétique correspond à l’étude des gènes, l’épigénétique s’intéresse à une couche d’informations complémentaires qui définit comment ces gènes vont être plus ou moins utilisés par une cellule. L’épigénétique, pourvue du préfixe grec « épi » qui signifie « sur », représente ce qui « s’ajoute aux gènes ».
En d’autres termes, l’épigénétique correspond à l’étude des changements dans l’activité des gènes, n’impliquant pas de modification de la séquence d’ADN. Il s’agit en outre de modifications pouvant être réversibles, et susceptibles d’être transmises lors des divisions cellulaires même aux générations futures. Au total, les modifications épigénétiques régulent l’expression des gènes, en augmentant ou diminuant la production des protéines.
Pour bien comprendre l’épigénétique, il faut revenir aux éléments basiques de la génétique. Premièrement, les molécules d’ADN des cellules vivantes des mammifères sont formées de deux brins antiparallèles enroulés l’un autour de l’autre pour former une double hélice. Deuxièmement, chaque brin, dénommé acide nucléique, est constitué de nucléotides, formé d’un sucre à cinq carbones (le désoxyribose), d’un phosphate et d’une base azotée. Et troisièmement, il existe quatre bases azotées différentes : l’adénine (A), la thymine (T), la cytosine (C) et la guanine (G).
Dans un acide nucléique, les nucléotides sont reliés entre eux selon une certaine séquence qui est abrégée par une lettre code, A-G-C-T-T-A-C-A. L’ordre dans lequel se succèdent les nucléotides le long d’un brin d’ADN constitue donc la séquence de ce brin, qui porte l’information génétique. Celle-ci est structurée en gènes qui sont transcrits en ARN messagers et qui sont traduits en protéines dans le cytoplasme au niveau des ribosomes. La succession des bases nucléiques A, T, G et C sur l’ADN détermine donc la succession des acides aminés qui constituent les protéines issues des gènes. Au final, le code génétique résulte de cette correspondance entre bases nucléiques et acides aminés.
Or, le récent séquençage des génomes a confirmé que la seule connaissance de la séquence de l’ADN ne suffit pas à expliquer comment les gènes fonctionnent, puisque, malgré leur génome identique, les différents types de cellules d’un individu développent des caractères aussi différents que ceux d’un neurone, d’une cellule du foie, des muscles ou de la peau. On a donc fini par conclure que le génome, qui possède toutes les informations génétiques nécessaires à la fabrication d’un organisme, n’est pas utilisé partout et tout le temps. Par la suite, on s’est rendu compte que dans les cellules différenciées, seulement 15% environ des gènes sont actifs.
Depuis la découverte de l’ADN, en 1953, le dogme voulait pourtant que tout y soit écrit simplement sous la forme d’une succession de bases azotées A, T, C, G et que la diversification du vivant ne puisse qu’être consécutive à des modifications des génomes par mutations, avec une transmission des caractères d’une génération à l’autre, de façon non réversible. Aujourd’hui, toutefois, il est prouvé que l’ADN n’est pas le seul maître à bord, car l’expression des gènes qu’il contient est soumise à diverses modifications dites « épigénétiques ». Quand on a découvert que les 22 000 gènes codant des protéines correspondaient à moins de 2% du génome environ, l’insatisfaction fut de taille. La majeure partie de l’information génétique qui n’était pas codante fut d’ailleurs nommée « poubelle » ! En fait, cet « ADN poubelle » contenait des ARN non codants qui participent à la réglementation de la fonction des gènes, c’est-à-dire à ce système épigénétique. On sait également que ces modifications sont transmissibles de cellule à cellule, voire de génération en génération.
Et ce n’est pas tout. Nous avons découvert que ces modifications épigénétiques ne résident pas dans un bouleversement de la séquence codante du gène – la protéine exprimée par le gène étant la même –, mais dans l’ajout (ou la suppression) de petites molécules biologiquement actives – appelées les marques épigénétiques – dans des régions promotrices et régulatrices qui conditionnent l’expression du gène. En fait, un gène n’est qu’un segment d’ADN qui contient l’information nécessaire à la synthèse d’une ou de plusieurs protéines qui constituent l’organisme. Mais l’expression génétique n’est pas un processus qui épouse le concept TOR (du tout ou rien), comme s’il s’agissait d’un interrupteur qui n’aurait que deux états : marche-arrêt (on-off). Car il existe des niveaux intermédiaires, avec par exemple des gènes très actifs, surexprimés (synthèse importante) ou encore partiellement réprimés (synthèse très faible mais pas abolie).
Or, les modifications épigénétiques qui modulent ces expressions géniques sont induites par l’environnement au sens large, la cellule recevant en permanence toutes sortes de signaux d’information. On note ainsi que des signaux liés aux comportements, par exemple des éleveurs (alimentation, stress…), peuvent conduire à des modifications dans l’expression des gènes de leurs animaux, sans affecter leur séquence.
Sur les animaux d’élevage, cinq facteurs environnementaux ont d’ores et déjà été mis en évidence: la nutrition, le comportement, le stress, les toxines et la stochasticité 2. Ces facteurs agissent à la fois de manière individuelle et de manière concertée sur leur épigénome. Les informations épigénétiques permettent d’allumer, d’atténuer ou d’éteindre un type de gène en fonction du tissu dans lequel elles se trouvent, et donc également en réponse à des stimuli provenant de l’environnement. Enfin, on a découvert que ce phénomène peut être transitoire, mais qu’il existe des modifications épigénétiques pérennes qui persistent sur plusieurs générations, même lorsque le signal qui les a induites a disparu.
Quels mécanismes épigénétiques sur l’ADN ont été étudiés ?
Les premiers concernés sont des mécanismes baptisés de « méthylation ». C’est-à-dire le branchement par une enzyme, la méthyl-transférase, d’un radical méthyle CH3 (un atome de carbone et trois d’hydrogène) sur la cytosine (C) et d’un nucléotide à cytosine sur un brin de l’ADN 3. Après les travaux de Riggs 4, on a prouvé que la méthylation de la séquence codante d’un gène n’a pas d’effet sur son expression. C’est la méthylation de la région promotrice et des régions régulatrices qui affecte l’expression du gène. En effet, pour qu’un gène mène à la synthèse d’une protéine, il doit être lisible, c’est-à-dire accessible à différents complexes protéiques qui interviennent dans ce processus. Et les marques de méthylation localisées sur l’ADN vont le plus souvent obstruer les aires d’arrivée de ces complexes protéiques, conduisant ainsi à l’inactivation des gènes concernés.
Ensuite, il y a les mécanismes épigénétiques sur des protéines appelées « histones » qui structurent l’ADN. Chaque cellule diploïde d’un mammifère comme l’homme contient, en moyenne, deux mètres d’ADN. Or, grâce à un judicieux « compactage », ils sont contenus dans le noyau d’une cellule qui mesure 0,01 à 0,1 mm de diamètre. La molécule d’ADN s’enroule ainsi d’abord autour de « perles » nommées nucléosomes dont le cœur est formé de huit protéines – les histones. Les nucléosomes, autour desquels 1,75 tour d’ADN est enroulé, s’embobinent ensuite sur eux-mêmes de manière plus ou moins « serrée », formant ainsi des filaments de chromatine plus ou moins denses. Lorsque la chromatine est très tassée (hétérochromatine, compactage élevé de l’ADN), les gènes ne sont pas accessibles et ne sont donc pas exprimés. Les zones de la chromatine peu condensée (euchromatine) sont en revanche accessibles aux complexes enzymatiques qui permettent l’expression des gènes.
Les modifications épigénétiques, qui affectent les histones et qui permettent à la chromatine de passer de l’un à l’autre de ces états, sont beaucoup plus variées que sur l’ADN. En effet, les extrémités amino-terminales des histones se projettent à l’extérieur de la partie globulaire du nucléosome et sont soumises, en fonction de l’environnement, à des liaisons chimiques avec d’autres molécules par des enzymes spécifiques. Ainsi, en plus d’une méthylation, on peut avoir chimiquement un acétylation (introduction d’un groupe acétyle CO-CH3), ou une phosphorylation (addition d’un groupement phosphate PO3 sur des chaînes latérales des acides aminés comportant une fonction alcool comme la sérine et la thréonine), voir une ubiquitination ( fixation d’une protéine d’ubiquitine sur une lysine). Certaines de ces modifications chimiques stimulent l’expression des gènes, d’autres la bloquent. Pour que les gènes puissent être actifs, il faut donc que l’ADN soit déroulé. Or, en provoquant des réactions chimiques sur les histones des nucléosomes 5, certains facteurs environnementaux parviennent justement à ouvrir ou à fermer l’ADN, et donc à influencer l’activité des gènes.
En plus du code génétique, il existe donc un code épigénétique, qui sert à rectifier les directives de base. Or, l’information véhiculée par le génome reste très stable et ne s’adapte pas immédiatement à des changements imprévus. Elle est l’objet de processus d’altérations et de sélections aléatoires des gènes, processus qui peuvent s’étaler sur une échelle considérable de temps ou même ne jamais aboutir. Si le génome est très figé (les mutations sont rares à court terme), les modifications épigénétiques permanentes rendent en revanche l’épigénome très dynamique, permettant une adaptation rapide à une modification de l’environnement, sans pour autant « graver » à chaque nouvelle adaptation ce changement adaptatif dans le génome. Les gènes doivent donc non seulement pouvoir s’exprimer de manière régulée dans le temps et dans l’espace mais aussi coordonner leurs actions. Ils doivent également adapter leur fonctionnement à un environnement en perpétuel changement.
Quels sont les exemples les plus probants permettant d’illustrer comment des changements dans l’environnement précoce affectent profondément ces mécanismes ?
Des études ont notamment montré que la programmation comportementale de jeunes souriceaux dépend du comportement maternel, en particulier lors du maternage. Ainsi, des bébés rats souvent léchés par leur mère se sont montrés plus calmes. En effet, les premières semaines de vie, qui sont une période critique pour le développement du système nerveux, vont induire des phénotypes différents chez les petits au niveau de la réponse au stress : le léchage des rates ou des mères souris pendant le toilettage, en fonction de son intensité, a le pouvoir de moduler la régulation épigénétique du gène du récepteur aux glucocorticoïdes de leurs petits. Au Canada, Michael Meaney 6 a révélé que les empreintes épigénétiques de ces soins maternels se trouvaient, dans le cerveau des jeunes rats, au niveau de l’hippocampe et que le léchage modulait l’activité d’un gène protégeant les rats contre le stress.
Dénommé NRC31, ce gène produit une protéine faisant fonction de récepteur qui collabore à diminuer la concentration d’hormones de stress (le fameux cortisol) dans l’organisme. L’analyse des cerveaux de rats qui n’ont pas reçu assez d’affection par léchage a démontré que l’interrupteur lié au gène NRC31 était inactif, en raison d’une forte méthylation dans les neurones de l’hippocampe des rats, c’est-à-dire dans la zone au niveau cérébral qui intègre les stress ambiants. En conséquence, la quantité d’hormones du stress – le cortisol – augmente au niveau du sang et donc, même en l’absence d’éléments perturbateurs, les souriceaux vont vivre à l’état adulte dans un état de stress constant altérant leur santé et leur longévité.
De même, les animaux d’élevage qui ont été victimes de maltraitance en bas âge ont tendance à avoir une hyperactivité de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, l’axe normalement mobilisé lorsqu’on est exposé au stress. En effet, devant une menace, l’hypothalamus sécrète des hormones qui agissent sur l’hypophyse qui, à son tour, entraîne la sécrétion de cortisol par les surrénales. Le cortisol augmente alors l’état d’alerte, mais parallèlement se lie aux récepteurs glucocorticoïdes de l’hippocampe pour permettre un retour à la normale. Une étude coordonnée par Gustavo Turecki, directeur du département de psychiatrie de l’université McGill, au Canada, a montré sur des cerveaux d’hommes qui avaient eu une enfance difficile et qui s’étaient suicidés à l’âge adulte, une augmentation des changements épigénétiques dans le gène lié aux récepteurs glucocorticoïdes de l’hippocampe. Ils avaient donc moins de récepteurs.
Un autre exemple nous est fourni par les mouches du vinaigre. En 2009, l’équipe du professeur Renato Paro, de l’université de Bâle, a découvert qu’après le chauffage d’un œuf à 37 degrés avant éclosion, la mouche qui naissait avait les yeux rouges, alors qu’elle a toujours les yeux blancs. Il s’agissait donc d’une caractéristique acquise par l’influence d’un facteur externe, en l’occurrence, la température.
Et chez l’homme, qu’en est-il ?
De prime abord, à la naissance et pendant leurs premières années, les « vrais » jumeaux – jumeaux mono-zygotes qui proviennent de la division d’un œuf fécondé unique – ont une étonnante ressemblance, un visage et un corps en miroir. Mais à l’âge adulte, des dissemblances apparaissent alors qu’ils partagent le même génome. Certains ont le visage plus large, d’autres mesurent quelques centimètres de plus, et parfois, cette dissemblance s’exprime même de façon beaucoup plus patente. L’un peut développer une obésité et l’autre rester mince ; l’un peut être sain d’esprit et l’autre présenter une grave pathologie mentale (schizophrénie, autisme, maladie bipolaire…); l’un peut être en bonne santé et l’autre souffrir d’une maladie auto-immune (polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaque…), devenir diabétique, ou développer une maladie intestinale ou un cancer.
Les « vrais » jumeaux sont donc plus ressemblants à la naissance qu’ils ne le seront ultérieurement dans leur vie. Et plus le temps passera, plus ils seront différents physiquement, psychologiquement et plus encore médicalement.
Pourtant, les jumeaux monozygotes ont au départ strictement les mêmes gènes. En fait, comme tout être humain, ils accumulent tout au long de leur existence des changements épigénétiques différents qui permettent à leur organisme de s’adapter à l’environnement, au monde extérieur, et cela bien entendu sans modifier leur ADN. Comme les gènes ne se modifient pas en raison d’une forte stabilité, c’est bien l’épigénétique qui apporte des molécules au niveau de zones régulatrices pour moduler la production des gènes. Les changements épigénétiques ajoutent une couche d’information au code génétique. Le programme épigénétique peut donc être modifié tout au long de la vie, en fonction des différents phénomènes environnementaux auxquels les•hommes ou les animaux sont exposés.
Notes
- Ray K. Ng et John B. Gurdon, « Epigenetic memory of active gene transcription is inherited through somatic cell nuclear transfer », PNAS, 8 février 2005, vol. 102, no. 6:1957-62.
- Les effets stochastiques n’apparaissent pas selon le principe d’une cause qui induit toujours le même effet. Ils ne sont pas liés à un effet de seuil car il n’est pas possible de quantifier une dose pour laquelle un effet donné serait certain de se manifester.
- Plus précisément, cette méthylation n’a lieu que si le nucléotide à cytosine est suivi d’un nucléotide à guanine (G) sur le même brin de l’ADN : on parle de dinucléotide CpG (p pour phosphate). Il existe dans le génome des séquences courtes, enrichies en CpG, que l’on désigne sous le terme d’îlots CpG de taille supérieure à 500 paires de bases. Les îlots CpG sont majoritairement présents sur les régions 5’ régula- trices (séquences promotrices) de 40 à 50 % des gènes de mammifères.
- a) Arthur D. Riggs, « X inactivation, differentiation, and DNA methylation », Cytogenet Cell Genet., 1975; 14(1): 9-25.
b) Aharon Razin et Arthur D. Riggs, « DNA Methylation and Gene Function », Science,Vol. 210, 7 novembre 1980. - Qui sont aussi impliqués dans la régulation de processus nucléaires comme la transcription, la réplication ou la réparation de l’ADN.
- a) Ian C G Weaver, Nadia Cervoni, Frances A Champagne, Ana C D’Alessio, Shakti Sharma, Jonathan R Seckl, Sergiy Dymov, Moshe Szyf et Michael J Meaney, « Epigenetic programming by maternal behavior », Nature Neuroscience, Volume 7, N° 8, août 2004.
b) Patrick O McGowan, Aya Sasaki, Ana C D’Alessio, Sergiy Dymov, Benoit Labonté, Moshe Szyf, Gustavo Turecki et Michael J Meaney, « Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse», Nature Neuroscience, 2009: Mars; 12(3): 342–348.