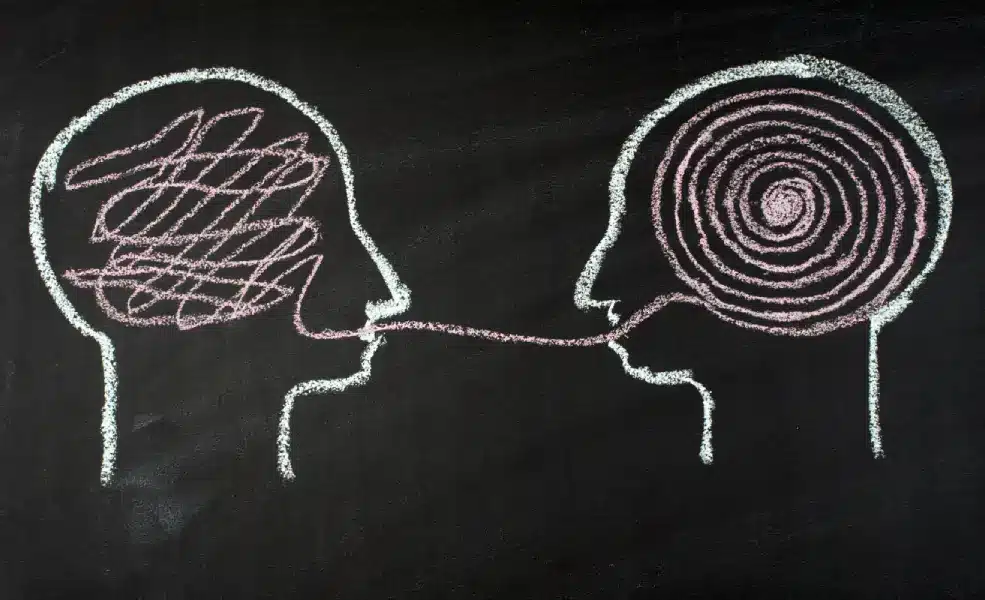Le docteur Jérôme Barrière, oncologue à Cagnes-sur-Mer, très investi dans les réseaux sociaux, apporte une critique salutaire au discours anxiogène qui circule sur les questions relatives à la santé. Il a accepté de répondre à quelques questions d’A&E
Vous intervenez régulièrement pour mettre en garde contre l’instrumentalisation de la peur dans le débat public. Pouvez-vous nous en donner un exemple récent ?
Oui. La pétition contre la loi Duplomb sur l’acétamipride en est une très bonne illustration. Elle s’inscrit dans un schéma déjà vu avec le glyphosate : à partir de données fragiles, voire inexistantes, on diffuse un message alarmiste suggérant qu’il y a un danger sanitaire majeur, sans avoir la moindre confirmation des instances d’expertise. Dans le cas de l’acétamipride, certains responsables politiques ou opposants à la loi Duplomb ont ainsi systématiquement accolé les termes de cancer ou maladies neurodégénératives à cette molécule, sans jamais discuter de ses spécificités toxicologiques.
Justement, quels risques pour la santé présente l’acétamipride ?
Selon les évaluations d’instances indépendantes (l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’Anses et l’Agence européenne des produits chimiques), aux doses d’exposition réelles pour la population générale, l’acétamipride n’a pas démontré de danger cancérogène ni de toxicité majeure. Rien n’étaye donc un risque accru de cancers, comme l’assurent régulièrement certains intervenants dans les médias.
C’est grave, car non seulement c’est faux, mais cela fait écran à la hiérarchisation des risques. En santé publique, on sait que le tabac cause à lui seul 75 000 morts par an en France, soit l’équivalent de la ville de Pau rayée de la carte, plus de dix ans avant l’heure. Cela représente un décès toutes les 7 minutes. À cela s’ajoutent 3 000 à 5 000 décès annuels de non-fumeurs dus au tabagisme passif, parmi lesquels on compte des enfants et des nourrissons (avec un doublement du risque de mort subite). Rien à voir avec l’hypothétique risque lié à l’acétamipride dans l’alimentation.
D’ailleurs, de façon plus générale, si un produit utilisé par les agriculteurs provoquait vraiment une explosion de cancers, on le verrait d’abord chez eux, puisqu’ils sont les plus exposés. Mais les chiffres montrent justement l’inverse : pour le cancer du pancréas, par exemple, le risque relatif est diminué de 28 % chez les hommes agriculteurs et de 16 % chez les femmes agricultrices. De plus, aucune différence d’incidence n’apparaît entre les pays selon le niveau d’usage des pesticides. Ce genre de données devrait inciter à plus de réserve, voire à rassurer.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a pourtant pris position contre cette loi, en affirmant que les « alertes ne peuvent être ignorées ». Comment l’expliquez-vous ?
Je comprends la vigilance exprimée par l’Ordre : son rôle est de protéger la santé publique. Mais il y a une différence entre signaler une alerte et présenter un danger comme établi. Ici, on confond une hypothèse avec une certitude !
Dans la pétition signée par de nombreuses sociétés savantes et associations (dont certaines contre le cancer alors qu’il n’y a aucun lien avéré avec ce produit), j’ai trouvé des affirmations qui m’ont choqué par leur manque de rigueur. On peut lire, par exemple : « Plus cette substance est présente dans les urines des femmes enceintes, moins le quotient intellectuel de leurs enfants à naître est élevé. » Or, en demandant la source à l’un des coauteurs, j’ai découvert que l’étude citée avait exclu l’acétamipride des analyses, faute de détection suffisante ! En outre, les conclusions réelles de cette étude sont bien plus nuancées que celles relayées dans la pétition.
La peur se répand d’autant plus facilement qu’on entend souvent parler d’une « explosion des cancers », notamment chez les jeunes. Cela correspond-il à une réalité ?
Eh bien non, cette information reprise très souvent ne correspond pas à la réalité, même s’il est vrai qu’en nombre absolu, le nombre de cas a augmenté très significativement chez les moins de 50 ans. Je m’explique. L’étude récente, qui a en effet fait couler beaucoup d’encre, rapporte une augmentation mondiale de 79,1 % de l’incidence des cancers précoces entre 1990 et 2019.
La presse n’a pas hésité à conclure à un doublement des cas, ce qui effectivement peut faire peur ! Or, durant cette période, la population mondiale a augmenté de 47,2 %, passant de 5,3 à 7,8 milliards d’habitants. Quant à la population âgée de moins de 50 ans, elle n’a augmenté que de 34,6 %, signe au passage d’un vieillissement global de la population. Si la proportion des cancers précoces était restée constante depuis 1990 (soit 12,25 % des cancers), on aurait mesuré environ 2,45 millions de cas en 2019, alors que le nombre réel observé est de 3,26 millions, correspondant donc à une augmentation effective de 32,8 %.
Cette augmentation réelle, bien qu’importante, est loin du « doublement » évoqué dans la presse ou même de représenter « une explosion ». En France (d’après Globocan), 15 000 personnes âgées de 20 à 40 ans sont touchées par un cancer chaque année. L’augmentation en 30 ans de l’incidence serait donc d’environ 5 000 cas annuels. C’est certes significatif, mais loin du « tsunami » annoncé sur les plus de 430 000 cancers diagnostiqués chaque année en France, puisque cela représente environ 1 % du total annuel…
Comme pistes expliquant cette hausse potentiellement évitable, on invoque le mode de vie, les évolutions de régime alimentaire, l’augmentation de l’obésité, notamment chez les enfants… On appelle cela « l’effet cohorte », c’est-à-dire l’ensemble des facteurs de risque que subit une génération.
En ce qui concerne plus particulièrement les enfants, il est là aussi faux de prétendre que les cancers ont « explosé ». Au contraire, les taux standardisés sont stables depuis 20 ans en France ! Ce qui suscite les peurs, c’est l’apparition ici ou là, ponctuellement, d’un « cluster ». Il s’agit d’un agrégat spatio-temporel qui désigne un regroupement de personnes ayant une même maladie ou les mêmes symptômes dans une zone géographique et pendant une période données, et dont le nombre rapporté à sa population est inhabituellement élevé. On parle d’une vingtaine de clusters ou registres jusqu’ici répertoriés sans aucune cause formelle ou unique mise en évidence. Et comme le nombre de cas anormaux cesse au bout d’un temps relativement court, on conclut que le plus probable est que cette succession de cas soit liée au hasard.
Malheureusement, pour beaucoup d’entre nous, l’idée que l’origine d’une maladie soit due au hasard est difficilement acceptable, et on préfère souvent trouver une cause et un coupable
Malheureusement, pour beaucoup d’entre nous, l’idée que l’origine d’une maladie soit due au hasard est difficilement acceptable, et on préfère souvent trouver une cause et un coupable. C’est ce qui explique que des familles se sont regroupées en association, épaulées par certains scientifiques bénévoles. On peut les comprendre, mais en revanche, il est inadmissible que des responsables politiques crient au scandale d’État, sans preuve. Il est faux de laisser entendre qu’on empoisonnerait nos enfants en leur faisant manger des salades de supermarché ou en ne leur faisant pas boire du lait bio !
Alors que vous dénoncez la « fabrique de la peur », certains journalistes estiment que vous participez à la « fabrique du doute », une « rhétorique visant à miner la confiance dans les résultats scientifiques ». Que répondez-vous ?
C’est un procès d’intention commode et pervers, car il permet d’étiqueter le contradicteur sans répondre sur le fond.
Sur les sujets que nous avons abordés, ma position n’est pas de « relativiser » la science, mais au contraire d’aligner le débat sur ce que disent les données publiées. Il est indispensable de rappeler les niveaux d’exposition réels, les marges de sécurité, l’incertitude quand elle existe, de faire la différence entre danger et risque d’exposition, de dénoncer tout travestissement des données publiées. C’est exactement l’inverse de la rhétorique du doute : c’est du scepticisme scientifique légitime, qui s’appuie sur la hiérarchie des preuves et accepte de changer d’avis…
Qualifier cela de « fabrique du doute », c’est pratiquer un stratagème rhétorique : disqualifier l’interlocuteur plutôt que discuter les chiffres, commuter le débat des faits vers les intentions, et substituer l’indignation à l’analyse. Or, on ne protège pas mieux les citoyens en dramatisant des risques faibles ou hypothétiques ; on les protège en priorisant les causes majeures de mortalité (tabac, alcool, sédentarité, pollution), en proportionnant les décisions à l’ampleur des preuves, et en rendant transparents les incertitudes comme les conflits d’intérêts potentiels.
Je le redis fermement pour conclure : revenir à un rationalisme factuel, non gouverné par la peur, est un enjeu démocratique majeur.