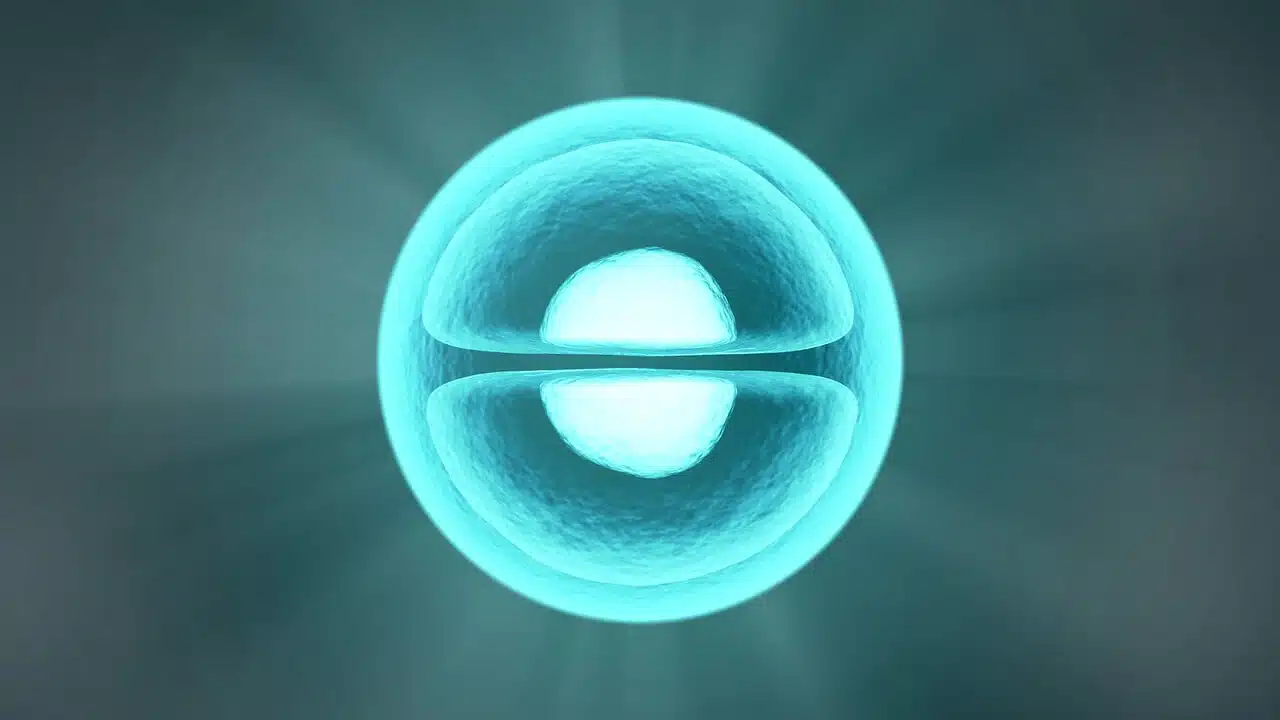Rencontre avec Agnès Ricroch, chercheure à l’université Paris-Sud et membre de l’Académie d’agriculture, au sujet de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)
Quelle lecture la communauté scientifique fait-elle de l’arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la CJUE ?
L’arrêt implique que les organismes issus des techniques de mutagenèse ciblée doivent être évalués comme ceux issus de la transgénèse et non pas comme les techniques de mutagenèse plus anciennes, moins sophistiquées, employées depuis les années 1920 (rayons gammas ou X, ou encore la mutagenèse réversible avec des agents chimiques). Or, si ces dernières sont exemptées des contraintes de la Directive européenne 2001/18, il n’y a aucune raison que les techniques de mutagenèse ciblée, plus précises, plus récentes et largement plus maîtrisées que les anciennes – puisqu’on sait exactement quel type de mutation a eu lieu dans le génome – ne le soient pas également. C’est d’autant plus important que, dans le monde entier, les sélectionneurs ont besoin de ces techniques – comme les enzymes appelées ciseaux à ADN de type « CRISPR », ou les TALEN, c’est-à-dire les outils d’édition génomique – pour améliorer leurs méthodes de sélection des plantes. Et la recherche publique française est également frappée d’une paralysie soudaine, en raison du ou dans la réglementation qu’entraîne cet arrêt.
À LIRE AUSSI : Le débat sur la mutagénèse relancé
Comment se positionnent les autres pays face à cette problématique ?
Certains pays, notamment les Pays-Bas et la Suède, ont déjà entamé des programmes de recherche impliquant ces techniques, et ils comptent bien continuer en attendant de connaître le positionnement définitif de la Commission européenne, qui doit statuer sur le sujet, suite à l’arrêt de la CJUE.
En revanche, en dehors de l’Union européenne, de plus en plus de pays ont adopté une démarche différente. Ainsi, au Canada, il n’y a pas de réglementation spéciale concernant les organismes issus de la mutagenèse ciblée, puisque toute l’évaluation s’effectue sur la base du produit final et non des techniques utilisées. Quelques plantes obtenues avec ces techniques y sont d’ores et déjà commercialisées. De même, aux États-Unis, ces variétés ne font pas l’objet d’une réglementation identique à celles obtenues par transgénèse. En Amérique latine, l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay se sont, eux aussi, engagés à promouvoir ce type de techniques sans les soumettre à une lourde réglementation. Tout comme en Israël et au Japon, deux pays qui considèrent qu’il ne faut pas légiférer sur la mutagenèse comme sur la transgénèse, où des programmes de recherche impliquent déjà ces techniques. Enfin, en ce qui concerne la Chine, leader dans le domaine agricole avec les États-Unis, la réglementation est en cours, mais au regard des dépôts de brevets avec CRISPR des laboratoires publics et des investissements engagés dans les biotechnologies, il est difficile d’imaginer que ce pays puisse se priver des dernières avancées de la science…
De fait, ce que révèle l’arrêt de la CJUE, c’est que la Directive 2001/18 est devenue obsolète. En effet, la Directive définit un organisme OGM par le fait que la transgénèse serait une technique « artificielle ». Elle a d’ailleurs été rédigée afin d’imposer aux variétés obtenues par cette technique des contraintes réglementaires spécifiques. Or, de nombreuses variétés développées dès les années 1920 et 1930 sont issues de techniques artificielles ! À cette époque déjà, les sélectionneurs ont utilisé des agents chimiques ou des rayons gamma ou UV pour modifier le génome des plantes. Beaucoup de variétés sont donc le fruit d’un travail qui a été réalisé en laboratoire, notamment avec la culture in vitro qui permet de faire pousser à partir de quelques cellules des plantes entières. Plus de 3500 types de plantes ainsi obtenues sont actuellement commercialisées dans le monde, dont certaines en agriculture bio. Pour la Commission européenne, ces techniques ont été exclues de la Directive au motif que leur usage ancien créait des variétés qui n’offrent aucun risque pour la santé et l’environnement. On voit donc bien les limites de la Directive, puisqu’il s’agit de plantes obtenues par des méthodes « artificielles ». D’autant plus que l’on sait aujourd’hui que la transgénèse, c’est-à-dire le transfert horizontal de gènes, existe dans la nature !
Que proposez-vous pour sortir de ce paradoxe ?
L’expérience a montré que la Directive a eu pour conséquence de freiner la recherche européenne et la créativité dans le développement de nouvelles variétés intéressantes qui répondent aux défis actuels, comme l’adaptation à des pratiques agricoles à bas intrants, la tolérance à des modifications climatiques ou l’augmentation de la qualité des produits alimentaires. Il s’agit donc d’un retard de la recherche publique que l’avis de la CJUE risque encore d’aggraver. Les législateurs doivent revenir à la raison et examiner ce dossier à partir des seules connaissances de la science, sans plus se laisser contaminer par le discours idéologique… En adoptant, par exemple, une réglementation similaire à celle du Canada, où ce sont les produits eux-mêmes qui sont évalués pour l’environnement et la santé humaine ou animale, en fonction de leurs caractéristiques et indépendamment des techniques utilisées. Il n’est pas normal qu’une variété résistante à un pathogène, qui serait obtenue par mutagenèse ciblée, soit soumise à une réglementation spécifique, alors que la même caractéristique, obtenue par mutagenèse aléatoire, en soit exempte.